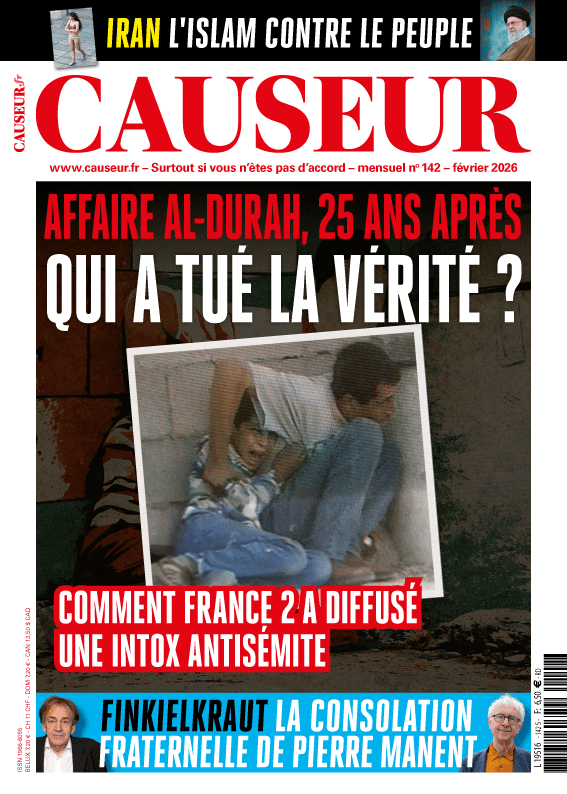L’ancien ambassadeur de France en Algérie (de 2008 à 2012 puis de 2017 à 2020) propose des solutions pour que les deux pays établissent enfin une relation adulte, sans chantage affectif ni délire de persécution, afin de normaliser, voire banaliser, des rapports bilatéraux.
Les toutes récentes déclarations à la presse du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, le 5 octobre, et le catalogue de critiques envers la France posent la question de notre relation avec l’Algérie et plus exactement celle de la nature de cette relation. Peut-on continuer soixante-deux ans après l’indépendance de l’Algérie à être perpétuellement accusés des crimes de la colonisation ? En un mot, comment inverser les rôles, comment cesser d’être mis en accusation par Alger sur tous les sujets, comment et pourquoi faut-il normaliser, voire banaliser notre relation bilatérale ? Dit plus crûment, comment ne plus être l’otage d’Alger ?
Rappelons d’abord les stupéfiantes déclarations du président algérien : face à deux journalistes chargés de lui donner la réplique, quelques jours après sa triomphale réélection à 95 % des voix (taux corrigé une semaine plus tard à 85 % des voix, taux plus « présentable » avec une participation de 10 % du corps électoral, selon l’Élysée), le chef de l’État algérien s’est livré à une attaque systématique et d’une rare violence à l’encontre de la France.
Évidemment, plus question de visite d’État à Paris (« je n’irai pas à Canossa »), pas question non plus de faire revenir à son poste l’ambassadeur d’Algérie en France. D’ailleurs, ce dernier a été nommé à Lisbonne et le poste de Paris sera sans doute inoccupé pendant la nouvelle crise. Mais, comme souvent faute d’arguments, le président algérien n’hésite pas à accuser les lobbies, « un petit groupe anti-algérien », presque un « quarteron de nostalgiques de la colonisation », d’exercer des pressions sur le gouvernement français, à preuve les dernières déclarations du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau et la volte-face française sur le Sahara occidental. C’est d’ailleurs, soulignons-le, ce changement de position diplomatique fin juillet qui est à l’origine de la quatrième ou cinquième crise du septennat d’Emmanuel Macron. Et de citer pêle-mêle l’accord franco-algérien de 1968, qui serait une « coquille vide » peu utile à l’Algérie, les essais nucléaires français qui méritent indemnisation et nettoyage, et comme de coutume, le génocide français qui visait, par la colonisation, à un grand remplacement des musulmans d’Algérie par des chrétiens ! Le président Macron avait donc vu juste lorsqu’en septembre 2021, il ciblait la « rente mémorielle » et la « falsification de l’histoire » par le « système politico-militaire algérien ».

Il faut relire à deux fois ces stupéfiantes déclarations. Essayons de reprendre ces accusations algériennes et d’analyser sérieusement, et non sur le mode polémique et accusateur, ces différents dossiers.
Le 30 juillet, Paris a effectivement décidé, dans une lettre adressée par le président de la République au roi Mohamed VI de reconnaître la « marocanité » du Sahara occidental et de soutenir le plan d’autonomie marocain. Alger a vu un lâchage, une volte-face cynique de la part d’un membre permanent du Conseil de sécurité dans ce changement de position. Il faut rappeler que la France n’a pourtant pas négligé d’infinies précautions pour amadouer Alger et ne pas froisser la susceptibilité du locataire d’El Mouradia. Une conseillère du président de la République s’était, fin juillet, rendue à Alger, pour soumettre aux autorités algériennes le texte de la lettre que comptait écrire le président au roi du Maroc, ce qui en dit long sur notre indépendance diplomatique. En septembre, la même collaboratrice de l’Élysée s’est une nouvelle fois rendue à Alger pour s’entretenir avec le chef de l’État algérien et l’inviter une fois encore à Paris ! On peut donc dire que la France a été très respectueuse de la diplomatie algérienne : Paris, pour se rendre à Rabat, n’a pas hésité en effet par faire le chemin de Canossa ; le Sahara occidental et l’amitié du Royaume chérifien valent bien une messe.
A lire aussi: Algérie, l’heure des comptes
Mais si le président a fait le choix marocain, c’est peut-être parce qu’il a réalisé qu’il n’y avait décidément rien à attendre d’Alger alors que depuis 2017, les gestes français n’ont jamais été payés de retour : déclaration d’Alger en août 2022, comité d’historiens, gestes mémoriels, visas, nombreux massages élyséens, rien n’y a fait : la réponse algérienne n’a été qu’une longue suite d’insultes depuis 2022 ou au mieux de bouderies ; fermeture des écoles privées algériennes, interdiction de l’usage du français, interdiction faite aux élèves algériens de passer le baccalauréat français en Algérie, remplacement du français par l’anglais, réintroduction du cinquième couplet dans l’hymne national algérien et, évidemment, absence de coopération pour la délivrance des laissez-passer consulaires, préalables à l’exécution des OQTF. Autant dire que les efforts français n’ont servi à rien. Paris a finalement fait le « pari marocain » au détriment de l’« impasse algérienne ». On pourrait ajouter à cela les provocations de la mosquée de Paris, les ingérences dans la politique intérieure française, notamment pendant les émeutes parisiennes de juillet 2023 : à chaque geste de Paris répondait une rebuffade algérienne. Les critiques du président algérien, on le voit, tombent à plat.
Le deuxième reproche fait dans son interview par Abdelmadjid Tebboune concerne l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que, à la suite de la publication d’une note de la Fondapol en mai 2023, toute la classe politique française a critiqué en demandant son abrogation. En un mot, l’argumentation algérienne consiste à dire : vous, Français, reprochez aux Algériens les privilèges obtenus par cet accord de 1968, alors que si vous regardez bien, il pénalise les Algériens et est de fait une « coquille vide ». C’est évidemment faux et une interprétation mensongère de la part d’Alger.
Là encore, il faut expliquer les choses sérieusement. Le président algérien a raison sur un point, et seulement sur un point : l’accord du 27 décembre 1968 est moins avantageux pour les Algériens que ne l’étaient les accords d’Évian qui, dans une de leurs annexes, postulaient la libre circulation entre la France et l’Algérie. En effet, lors des négociations tenues à Lugrin, Les Rousses et Évian, il était envisagé que les pieds-noirs qui resteraient en Algérie devaient pouvoir revenir librement, sans entraves, en France même s’ils avaient opté pour la nationalité algérienne. Il suffit de lire le verbatim des négociations d’Évian publiées récemment par le Quai d’Orsay pour vérifier cette thèse. Or, en juillet 1962, la très grande majorité des pieds-noirs quittèrent l’Algérie et, de ce fait, la liberté de circulation ne bénéficiait désormais qu’aux Algériens : c’est la raison pour laquelle, cinq ans plus tard, en 1968, les deux gouvernements négocièrent un nouvel accord. Ce texte supprime la libre circulation prévue à Évian (et en ce sens, Tebboune a raison, le texte de 1968 est moins avantageux pour les Algériens) mais, en contrepartie, il accorde de nombreux privilèges aux ressortissants algériens en matière de regroupement familial, de conditions d’intégration, de transformation de visa étudiant en visa de commerçant, de titre de séjour (le fameux certificat de résidence algérien valable dix ans), tous privilèges que n’ont pas les autres nationalités. Certes, un certain nombre de ces avantages furent rognés par la suite ou accordés aux autres nationalités, comme le passeport-talent. Mais dans l’ensemble, l’accord franco-algérien de 1968 est avantageux pour les Algériens. En particulier parce que, en raison de la hiérarchie des normes en droit français, les Algériens échappent aux lois françaises sur l’immigration pour ne dépendre que de l’accord de 1968. Le juge français, le Conseil d’État, rappelle régulièrement dans ses arrêts que les ressortissants algériens (qui représentent quand même plus de 50 % de l’immigration en France) ne sont pas soumis aux lois françaises en matière d’immigration et ne dépendent que de l’accord de 1968 ; il annule donc les refus de titres de séjour par les préfectures, ou les refus de visas, refus décidés sur le fondement des textes de lois françaises, en excipant de la primauté de l’accord franco-algérien de 1968. On voit donc, là encore, l’énorme privilège dont bénéficient les Algériens qui échappent aux lois françaises.
D’ailleurs, dans sa déclaration, le président algérien se contredit quand il affirme que cet accord est une coquille vide qui ne sert aujourd’hui à rien. Dans ce cas, pourquoi hurler et injurier ceux qui d’Édouard Philippe à Jordan Bardella en passant par Nicolas Sarkozy ou Manuel Valls recommandent l’abrogation de ces privilèges ? Mieux inspiré, un an plus tôt, le même Tebboune, dans Le Figaro, indiquait que les Algériens avaient droit à l’application de cet accord durant 132 années, soit autant que la durée de la colonisation française. L’accord de 1968, c’est la poule aux œufs d’or !
La troisième charge du président algérien porte sur les « crimes français » pendant la colonisation, de Charles X aux essais nucléaires français, avec deux affirmations nouvelles destinées au « grand public » algérien. D’une part, l’idée d’un « grand remplacement » voulu par la France d’une population musulmane par des chrétiens. Cette affirmation est nouvelle, et sans doute destinée à flatter les islamistes et plus généralement la population algérienne, pour montrer que le « système » est le meilleur protecteur des musulmans algériens. Cette affirmation étonne d’autant plus qu’aujourd’hui, les minorités chrétiennes d’Algérie sont persécutées et malmenées par le régime en place, à commencer par les églises évangélistes suspectes de jouer l’indépendance de la Kabylie. La deuxième revendication porte sur la nécessité d’indemnisation et de nettoyage des sites nucléaires français. Là encore, le président algérien oublie de rappeler que ces essais nucléaires ont été menés avec l’accord explicite et écrit du gouvernement algérien jusqu’en 1967, comme le montre le texte des négociations des Rousses et d’Évian. Le chef de l’État algérien avait, dans le dernier entretien que j’ai eu avec lui, évoqué rapidement cette question, mais sans insister. Lui-même avait d’ailleurs insisté sur le fait que le gouvernement algérien avait donné son accord et qu’il était donc difficile en droit international de critiquer la France.
Le discours de Tebboune est évidemment à usage interne : mal réélu, à la tête d’un système politique fragile prêt à contester sa légitimité, otage de la puissante armée algérienne, en butte à un pays hostile (le taux de participation de 10 % à l’élection présidentielle comme les nombreux harragas qui se pressent pour fuir l’Algérie en sont le signe), isolé diplomatiquement (le Maroc, le Mali, la Libye sont en embuscade et le président malien a traité des dirigeants algériens d’énergumènes à la tribune de l’ONU), le chef de l’État algérien n’a sans doute d’autre choix que cette fuite en avant.
Cela dit, que faire à présent ? Face à ces attaques, la France a, pour faire simple, deux possibilités.
Tout d’abord, poursuivre comme si de rien n’était. Jusqu’à présent, et depuis 2017, le président français a ignoré les attaques algériennes et cherché à calmer le jeu, y compris dans les pires moments. Paris n’a jamais protesté ou rappelé son ambassadeur lorsque le président algérien attaquait la France et ciblait personnellement son homologue français : à chaque insulte répondait un coup de téléphone, un message porté par un émissaire, ou un voyage à Alger avec moult embrassades. Aux critiques algériennes répondaient un silence français ou de nouveaux gestes mémoriels. Nous n’avons pas gagné grand-chose à cette stratégie du silence, car ce dernier est pris pour de la faiblesse à Alger. Le président français, persuadé que lui pouvait, avec Alger, réussir là où aucun de ses prédécesseurs – de Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Jacques Chirac – n’avait réussi, a peut-être, sept ans plus tard, estimé que décidément, le jeu n’en valait pas la chandelle et que selon l’adage, « un septennat commence à Alger pour se terminer à Rabat ». C’est ce qui se passe aujourd’hui avec la prochaine visite d’État d’Emmanuel Macron à Rabat.
La deuxième option consisterait à créer un rapport de forces avec Alger, rapport de forces qui n’existe pas aujourd’hui. Nos dirigeants politiques, de droite comme de gauche, étant pour des raisons historiques dans une certaine « bien-pensance » à l’égard d’Alger, n’ont jamais voulu riposter ou au moins réagir vis-à-vis des provocations algériennes. Or, nous disposons de moyens de rétorsion et il suffirait, au nom de la réciprocité, terme compris à Alger, de les mettre en œuvre. Ce serait une sorte de « riposte graduée » :
En premier lieu, le gouvernement français pourrait envoyer un signal : dénoncer – il suffit d’un préavis de trois mois – l’échange de lettres signé par les deux ministres des Affaires étrangères le 10 juillet 2007 et qui exonère de visa les détenteurs de passeports diplomatiques français et algérien. Concrètement, les détenteurs algériens de passeports diplomatiques (diplomates, mais aussi l’État profond, hommes politiques, militaires, etc.) peuvent, sans visa, venir en France pour leurs affaires médicales ou personnelles. Avantage précieux ! Mettre fin à cet échange de lettres, ce qui relève de la compétence du seul ministre des Affaires étrangères, serait envoyer un signal.
A lire aussi: Mobilisation générale pour la libération de Boualem Sansal!
Autre mesure possible, évidemment, dénoncer l’accord franco-algérien de 1968. Considéré par Alger comme consubstantiel aux accords d’Évian, il est pour lui impossible et impensable de le dénoncer. Ce serait une mesure très forte de la part de la France que de mettre fin à ces accords.
Une variante serait aussi de ne délivrer un nombre de visas qu’au prorata des OQTF exécutées : l’Algérie ne délivrant que 7 % des laissez-passer consulaires nécessaires aux OQTF, la France pourrait ne délivrer que 7 % des visas demandés. Une telle mesure, extrêmement forte, ne pourrait avoir d’effet que si, au même moment, les États membres de l’espace Schengen revenaient sur la libre circulation permise par les accords de Schengen, car un Algérien qui se verrait refuser un visa par la France demanderait et obtiendrait de la part des consulats allemand, espagnol ou italien un visa qui lui permettrait évidemment de venir en France, destination ultime.
D’autres mesures peuvent être envisagées comme les facilités octroyées dans la Convention générale de Sécurité sociale de 1980, qui bénéficient exclusivement aux Algériens, peu de Français allant se faire soigner en Algérie. La double dette hospitalière algérienne, publique comme privée, se montait il y a quelques années à plus de 100 millions d’euros.
Évidemment, si un gouvernement voulait frapper fort, il pourrait regarder de plus près, via Tracfin, les transactions financières effectuées par les Algériens en France, que ce soit via des comptes à Dubaï, ou plus largement par les circuits financiers « officieux » gérés par les cafés de Paris ou Marseille. Le dinar algérien est inconvertible, les sorties de devises contrôlées, le dinar algérien a un cours parallèle mais bizarrement, les transactions algériennes en France prospèrent.
Le gouvernement pourrait tout autant se pencher sur les missions exactes de la Mosquée de Paris, que l’Algérie dirige et dont son recteur, véritable ambassadeur algérien en France, se permet d’intervenir régulièrement dans la vie politique française.

L’Algérie dispose enfin de 20 consulats en France où de nombreux proches du pouvoir font carrière, meilleur moyen d’avoir une « base arrière » familiale en France. Jusqu’à l’an dernier, l’Algérie se contentait de 18 consulats, ce qui était déjà beaucoup, mais dans sa générosité, notre ministre de l’Intérieur a, sans contrepartie, accordé l’ouverture de deux consulats supplémentaires, Rouen et Melun. Le rôle de ces consulats est avant tout de mobiliser les Algériens de France mais aussi… de délivrer des laissez-passer consulaires aux Algériens en situation irrégulière reconduits au pays. Si les consulats ne remplissent pas leur mission, c’est à dire refusent de délivrer les laissez-passer consulaires, à quoi donc servent-ils, alors qu’un échange de lettres franco-algérien de 1994 prescrit aux consulats algériens de délivrer ces LPC en échange d’un certain nombre de facilités ? Autant les fermer. Les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères pourraient d’autorité revoir cette carte consulaire ou, à tout le moins, convoquer solennellement les consuls pour les mettre en garde. Un diplomate n’aime pas être convoqué par un ministre pour recevoir un avertissement… En échange de l’ouverture des consulats algériens à Rouen et Melun, pourquoi n’a-t-on rien exigé ? Il ne faut nous en prendre qu’à nous-mêmes et Alger le sait.
La conclusion de tout cela serait évidemment et logiquement de tenir un langage de vérité et de fermeté aux Algériens et tout compte fait, d’inverser la charge de la preuve : soixante-deux ans après l’indépendance, il faut en effet pouvoir construire une relation normalisée ; soixante-deux ans, c’est largement l’âge adulte… Il est temps de poser franchement la question en ces termes : « Oui ou non, voulez-vous travailler avec nous ? Oui ou non, voulez-vous ce « partenariat d’exception » ? Si c’est le cas, c’est à vous et pas seulement à nous de donner de la substance et de la chair à ces termes. Vous, Algériens, êtes indépendants depuis 1962, et il ne sert à rien, plus de soixante ans après votre indépendance, que vous avez voulue, d’accuser la France de tous les maux qui vous frappent et de ressasser le passé que vous réécrivez. Le président français avait stigmatisé la « falsification de l’histoire par le pouvoir algérien » : il est temps de ne plus regarder dans le rétroviseur et de cesser en France d’être l’otage de la « pensée unique » algérienne. Nous avons, pour ce qui nous concerne, beaucoup progressé au cours des deux derniers quinquennats sur la question de la mémoire, mais nous aussi, nous attendons un retour, car nous aussi, nous avons des intérêts à défendre, nous aussi, nous avons une opinion publique.