Christopher Rufo est chercheur au Manhattan Institute for Policy Research. Son nouveau livre décortique au scalpel les théories radicales développées dans les années 1960 et 1970 qui ont progressivement capturé les institutions américaines. L’analyse de Michèle Tribalat.
Marcuse, le prophète
Christopher Rufo consacre de longs développements aux précurseurs des théoriciens critiques d’aujourd’hui. Pour Herbert Marcuse, la précondition à la révolution était la démolition de la culture, de l’économie et de la société existante. Sa théorie eut un succès immédiat à la fin des années 1960 des deux côtés de l’Océan. S’il fut parfois chahuté, ce fut par de jeunes militants nourris de sa philosophie et impatients d’en découdre. La Nouvelle Gauche, à travers toutes sortes de groupements (Weather Underground Organization, Black Liberation Army), se lança dans une guérilla, espérant ainsi soulever les masses opprimées. Pendant 15 mois en 1969-70, la police enregistra 4330 attentats à la bombe et 43 morts. C’est Nixon qui siffla la fin de la partie.
Constatant la défaite de cette stratégie violente, Marcuse conseilla aux militants de se retirer dans les universités et de pratiquer la stratégie formulée par Rudi Dutschke : « une longue marche à l’intérieur des institutions ». À l’université, pour s’emparer des moyens de production du savoir, il fallait former des étudiants qui deviendraient les cadres potentiels d’un nouveau mouvement révolutionnaire, lequel s’étendrait, par contagion, à la société toute entière. Le manifeste Prairie Fire de Bernardine Dohrn, Bill Ayers et Jeff Jones, paru en 1974, s’il fut un peu le chant du cygne des Weathermen, allait devenir le dictionnaire de la vie intellectuelle américaine et l’état d’esprit de Marcuse allait s’incruster et dominer sur les campus. Ajoutons, au triomphe posthume de Marcuse, le rôle joué par Erica Sherover-Marcuse, sa troisième épouse, qui fut une figure centrale du maquillage stratégique de la théorie critique en DEI (Diversité, Equité, Inclusion), « équivalent d’un bulldozer moral ». Aux oppressions cataloguées dans la théorie critique, DEI offrait le remède. De 1987 à 2012, Le nombre d’employés de l’administration des collèges et universités s’accrut de 500 000 et, en 2015, il était proche du million. Dans l’université californienne, devenue le « royaume d’un parti unique », le secteur DEI comprend 400 employés pour un budget annuel de 35 millions. Le rêve de Marcuse s’y est accompli. L’université y est devenue la première institution révolutionnaire. Une révolution quasiment invisible, réalisée d’en haut et formulée dans le vocabulaire des sciences sociales, allait s’étendre aux médias. La capture du New York Times, qui s’était autrefois moqué de Marcuse et de ses adeptes, fut un moment décisif. Les autres grands journaux de gauche suivirent. Vint ensuite la conquête des rouages de l’État qui s’opéra sans grande difficulté. Les programmes DEI ont constitué une manne pour les militants de gauche et sont devenus la culture dominante des organismes publics. La dernière conquête fut celle des grandes entreprises. Autrefois des cibles, elles sont devenues le véhicule des théories critiques. Les programmes DEI financent les organisations militantes mais sont, pour les patrons, une police d’assurance. Lors des émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd, cinquante grandes entreprises s’engagèrent ainsi à verser 50 milliards de dollars en faveur de l’équité raciale. Elles auraient autrefois payé les syndicats. Aujourd’hui, elles paient les organisations militantes engagées sur les questions raciales en espérant les amadouer.
A lire aussi : Médine sur Rachel Khan : pas d’islamo-gauchisme sans antisémitisme
D’Angela Davis aux Black Studies
Angela Davis, disciple de Marcuse, représentait l’union de l’intelligentsia blanche et du ghetto noir. Elle était favorable à l’action violente, si nécessaire, et, pour elle, le vrai combat contre le racisme ne pouvait commencer que lorsque serait détruit tout le système. Angela Davis ajouta à son parcours universitaire brillant aux États-Unis une formation à l’Institut de recherche sociale de Francfort, berceau des théories critiques. De retour aux États-Unis, elle prépara sa thèse sur Kant tout en donnant des cours. Communiste déclarée, son contrat de professeur assistant ne sera pas renouvelé en 1970. Elle fut membre du groupe qui participa à la prise d’otages dans le Palais de justice visant la libération des Soledad Brothers, prisonniers à San Quentin, et qui se termina par la mort de trois preneurs d’otages et du juge. Elle fut arrêtée, puis conduite à la prison pour femmes de New York où elle fut acclamée comme une star. Lors de son procès, Angela Davis réussit à mettre la société américaine au banc des accusés et à convaincre les jurés qu’elle en était victime. Elle fut déclarée innocente sous les acclamations de la salle. Davis devint ainsi une star internationale, accueillie comme telle dans les régimes communistes, de Cuba à Moscou en passant par Berlin-Est. Elle aimait se décrire comme une néo-esclave dans un pays dérivant vers le fascisme, à l’image de l’Allemagne avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Dans la même veine, la rhétorique du Parti des Black Panthers (BPP), qui avait popularisé le slogan « Kill the pigs » (pigs pour policiers), avait déchaîné une vague de violences qui s’acheva dans une zizanie, à l’intérieur du mouvement, inspirée par les infiltrations du FBI. Au lieu d’entraîner les quartiers noirs dans la révolte, les actions violentes y déclenchèrent la réprobation lorsque des policiers noirs furent tués. La révolution se termina par une attrition ne laissant subsister qu’une poignée de militants marchant à la cocaïne et dévalisant des magasins et des banques. Si Angela Davis les soutint jusqu’au bout en les présentant comme des combattants de la liberté, elle avait perdu de son influence. Elle ne réunit, avec son colistier Gus Hall, que 45 000 voix aux élections présidentielles de 1980, pour le parti communiste.
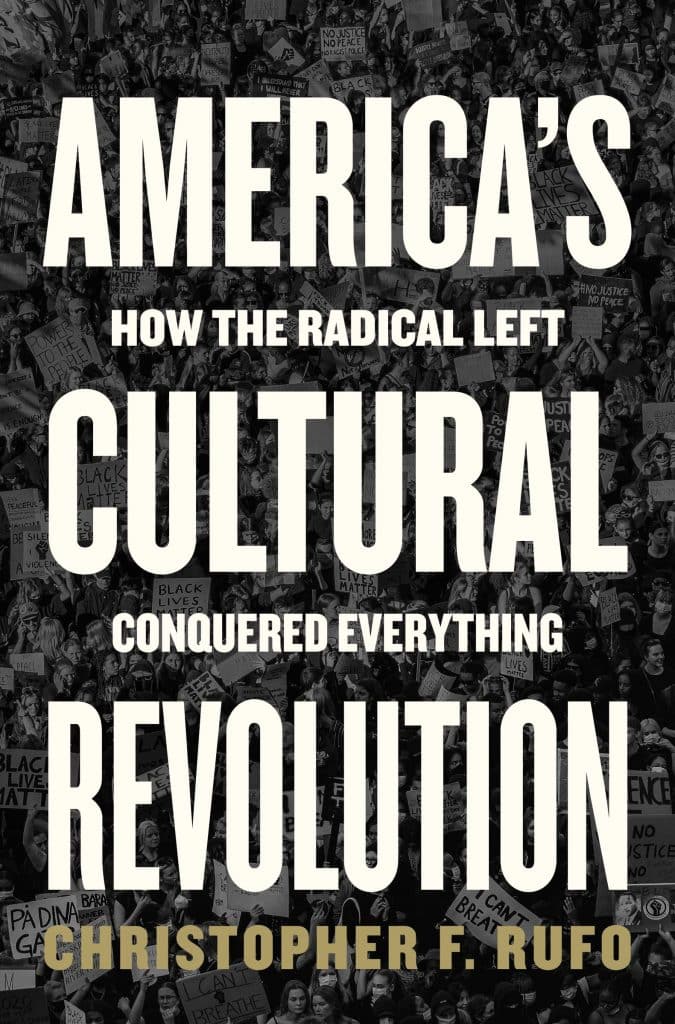
Angela Davis se réfugia à l’université et son combat changea de nature. Professeur et conférencière à l’UCLA, elle fit preuve d’un grand talent pour obtenir le soutien d’institutions qu’elle combattait. Son programme radical – faire de l’identité raciale et sexuelle le fondement de l’action politique – est devenu celui des sciences humaines. C’est un groupe de lesbiennes noires militantes, s’inspirant des travaux de Davis – Combahee River Collective – qui employa, pour la première fois, l’expression « identity politics » (politiques d’identité). Angela Davis et ses disciples ne demandaient plus la libération des prisonniers, mais l’abolition du système tout entier.
Ce mouvement, visant à connecter l’idéologie Black Panther au pouvoir administratif, essaima rapidement au-delà de San Francisco. Au milieu des années 1970, on dénombrait 500 programmes de Black Studies dans les universités américaines. Aujourd’hui, 91 % des universités publiques ont un programme de Black Studies.
Black Lives Matter (BLM) renoue avec la révolution
La grande victoire de BLM a été de s’assurer le soutien d’institutions prestigieuses. BLM n’a rien inventé sur le fond mais sur le langage et la présentation. BLM chercha ainsi à se concilier les élites afin de les mobiliser sur les questions raciales et sexuelles. Les enquêtes du Pew Research Center retracent l’évolution anachronique des perceptions de la question noire à gauche. En 2017, 76 % des Américains proches des Démocrates disaient que le racisme était un gros problème aux États-Unis contre 32 % en 2009. La mort de George Floyd aux mains d’un policier en 2020 déclencha une révolution culturelle, en marche depuis des décennies, et qui suivait à la lettre les propos d’Angela Davis à ses étudiants à l’UCLA : « Effacez le passé, démolissez le présent et contrôlez l’avenir ».
A lire aussi : La police n’est pas à plaindre
Des chaines de magasins ont commencé à afficher des banderoles en faveur de BLM. Avec un parfum soviétique, les médias américains ont présenté BLM comme une marche vers la libération, les exactions et les crimes n’étant, comme le clamaient les militants dans les années 1960, qu’une réaction à l’oppression. Seattle fut sans doute la ville qui exhiba la plus grande complaisance à l’égard des débordements violents et des prises de pouvoir locales, notamment dans la zone autonome CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone). Dans la CHAZ, les factions les plus armées et agressives devinrent la police de facto, avec un taux d’homicide 50 fois supérieur à celui de Chicago et dont toutes les victimes étaient noires, jusqu’à ce que la CHAZ soit reprise par la police du centre-ville.
Pédagogie critique : la révolution éducative
Le livre fondateur de la pédagogie critique est celui du Brésilien Paulo Freire. Il fut traduit en anglais en 1970 aux États-Unis où Freire avait trouvé refuge. Avec plus d’un million de copies vendues, c’est le 3ème livre le plus cité dans les sciences sociales. Sur la fin de sa vie, il collectionna les hommages et 27 doctorats honorifiques dans le monde.
D’après Paulo Freire, fidèle jusqu’au bout aux régimes communistes, la révolution doit commencer dans la salle de classe et se terminer dans la rue. En 1974, il qualifia la révolution culturelle chinoise de « solution la plus géniale du siècle » et c’est en Guinée-Bissau qu’il alla, à l’invitation du président Luis Cabral, l’expérimenter. Ce fut un fiasco. Après trois ans d’application de son programme auprès de 26 000 adultes, aucun n’en sortit alphabétisé. Ce qui n’empêcha pas la réactivation de son projet… aux États-Unis, pays qui, pour lui, incarnait le summum de l’oppression. Il y rencontra notamment Henry Giroux avec lequel il coédita une série de Critical Studies in Education. Ils comptaient, eux-aussi, sur la capture des universités pour que les théories critiques ruissèlent jusque dans les salles de classe. Et c’est ainsi qu’en 40 ans les théoriciens critiques réussirent à dominer le champ éducatif et introduisirent les idées et les concepts qui formatent aujourd’hui les discours sur la justice sociale. Des milliers d’écoles publiques forment ainsi des enfants à voir le monde à travers le prisme de la pédagogie critique. On prétend mettre à mal la domination de la culture chrétienne blanche, par exemple, en apprenant aux enfants des chants indigènes, y compris les chants des Aztèques qui pratiquèrent le sacrifice humain et le cannibalisme. En Californie, la pédagogie critique est devenue obligatoire. Il s’agit de décoloniser l’éducation (y compris les mathématiques dites occidentales) par un transfert de pouvoir des parents vers une classe bureaucratique, tout en offrant un débouché aux universitaires théoriciens critiques. De 1970 à 2010, dans les écoles publiques californiennes, le nombre d’élèves a augmenté de 9 % quand celui du personnel, dont la moitié n’enseigne pas, progressait de 130 %.
Les pédagogues critiques prônent une pédagogie différentiée à l’égard des oppresseurs et des opprimés. Aux « oppresseurs » est dédiée une pédagogie de la « blanchité » qui est censée les convaincre qu’ils sont « infectés » par « l’ignorance blanche », la « complicité blanche », le « privilège blanc», le « déni blanc » et la suprématie blanche ». Les Blancs doivent donc confesser leur racisme et subir un traitement de choc pour se purger. Ces pédagogues critiques voient dans la manipulation de l’identité raciale le moyen de faire advenir la révolution attendue à gauche : reformater la psychologie de l’enfant pour le conduire à militer et participer à la reconstruction d’un ordre social favorable à l’opprimé. Par exemple, en maternelle, on va montrer aux enfants une vidéo dans laquelle des enfants noirs morts leur parleraient, de leur tombe, et les mettraient en garde contre la police capable de les tuer à tout moment. En fin de lycée, les enfants ont exploré tous les secteurs de la domination du régime de blanchité. On encourage les élèves à imaginer un système de justice traditionnel africain qui se préoccuperait non de punir mais de réparer, privilégierait les valeurs collectives sur les droits individuels, interdirait la propriété privée. Une sorte de communisme primitif qui aurait existé avant tout contact avec les Européens. Cette pédagogie critique ne semble pas avoir eu de meilleurs résultats qu’en Guinée Bissau. Elle a capitalisé sur les théories de Paulo Freire en y mêlant une politique raciale manipulant la culpabilité, la honte, l’envie, la fierté pour induire les enfants dans un activisme identitaire. Même les enseignants d’anglais seconde langue pour immigrants doivent apprendre à ces derniers, qu’« aux États-Unis, le racisme est omniprésent comme l’air qu’on respire » et qu’il faut relativiser la victoire de la mobilisation des Noirs des années 1960. Cette pédagogie critique joue avec le feu. On a des enseignants et des administrateurs qui condamnent les enfants qu’ils sont censés éduquer à une vision du monde si pessimiste que le seul recours possible semble être la violence. Les institutions de Portland se sont ainsi enferrées dans le paradoxe d’un État dont le système éducatif concourt à sa propre destruction. Elles ont façonné le caractère éruptif de la jeunesse sans être sûres de pouvoir en supporter les conséquences.
A lire aussi : Est-il honteux d’être chauvin à la carte?
Du pessimisme radical de Derrick Bell à l’intersectionnalité
Derrick Bell est l’un de ceux qui plantèrent le décor des politiques raciales de notre temps. Il fut, en 1971, le premier professeur noir recruté à la faculté de droit de Harvard. Dans les années 1980, il abandonna son travail académique pour des fictions horrifiques sur le sort des Noirs et devint la star de l’intelligentsia blanche. Pour lui, la condition des Noirs était pire que durant l’esclavage. Les émules de Derrick Bell participèrent activement à la capture des institutions, laquelle était complète dix ans après la mort de ce dernier en 2011. Leur idéologie est devenue l’idéologie par défaut des universités, du gouvernement fédéral, des écoles publiques et des départements de ressources humaines des entreprises. Derrick Bell, lui aussi, pensait que la réforme ne viendrait pas d’un processus démocratique mais d’un remodelage des mœurs des élites. Il fut rejoint par des collègues dans ce qu’on appela les « critical legal studies ». Son activisme finit par lasser l’administration et, après deux ans de congé sans solde, il fut congédié de Harvard. D’après Thomas Sowell, Bell fut un des premiers à souffrir de l’Affirmative Action. Conscient d’avoir été recruté à Harvard parce que noir, Bell n’avait que deux options : vivre dans l’ombre de juristes plus accomplis ou se lancer dans un militantisme racial déchaîné. Un petit groupe des disciples de Bell firent des perceptions du maître un programme de recherche et d’action, la Théorie critique de la race (TCR), qui a changé le visage de la société américaine.
Le concept de TCR fut élaboré, lors d’une réunion de Derrick Bell et de ses disciples dans un ancien couvent – St Benedict – du Wisconsin, pendant l’été 1989 et dont Kimberlé Crenshaw fut l’une des organisatrices. De nombreuses publications suivirent. Un élément central de la TCR est une reconceptualisation de la vérité dans la ligne des postmodernistes. En rabaissant la rationalité à une forme de colonialisme académique dominé par les normes blanches et dont l’universalisme prétendu n’est qu’une forme de domination des minorités raciales. D’où la nécessité de redistribuer le pouvoir en faveur des minorités. Un autre élément central de la TCR est l’intersectionnalité (terme inventé par Crenshaw) qui étend la vision marxiste à une multiplicité d’oppressions hiérarchisées. L’oppresseur ultime est le mâle blanc non handicapé hétérosexuel, et la victime par excellence, la femme noire, qui devient une source d’autorité. La TCR appelle à l’action. Il faut ébranler l’hégémonie blanche par la subversion des institutions de l’intérieur et la création une contre-hégémonie dans la structure du pouvoir. Une fois le programme de la TCR connu, il reçut des critiques argumentées mais qui restèrent sans effet, tout en détruisant la réputation de leurs auteurs, notamment celle des auteurs noirs traités d’esclaves copiant leur maîtres blancs.
DEI ou la perversion du langage
À l’université, les méthodes des promoteurs de la TCR (vendettas, dénonciations…) leur permirent de gagner un statut dans les établissements d’élite. La tête de pont fut les facultés de droit. Puis, la TCR devenant un prérequis pour avancer sa carrière, elle conquit discipline après discipline. Le tout sous l’appellation DEI, apparemment moins provocante que TCR, mais qui reste une perversion du langage. Ainsi, diversité signifie l’inversion de la hiérarchie. L’équité recherche l’égalité réelle entre groupes. Quant à l’inclusion elle prend un sens opposé à son sens réel, soit la régulation du discours et du comportement pour protéger le bien-être subjectif de la coalition intersectionnelle. Les programmes DEI ont été imposés dans tous les organes du gouvernement fédéral, tout en faisant la fortune de quelques consultants spécialisés. Que veulent-ils ? Pour y répondre, Christopher Rufo recommande de retourner aux tout premiers textes de la TCR qui proposent une révision globale du système de gouvernance américain en trois points :
1) abandonner la notion d’égalité indifférente à la couleur. Le 14ème amendement ayant échoué à accomplir une égalité raciale substantielle, il faut l’étendre pour y inclure des droits économiques, ce qui suppose un système d’affirmative action, de quotas raciaux, de réparations et de droits fondés sur les groupes et non plus les individus ;
2) redistribuer la richesse en fonction de la race, y compris les propriétés privées confisquées puis redistribuées selon une répartition raciale ;
3) ce nouveau système fondé sur le droit des groupes serait appliqué grâce à une régulation du discours jugé haineux. Pour cela, il faudrait drastiquement restreindre le 1er amendement. Le sens des 1er et 14ème amendements et les protections de la propriété privée seraient détruits. Une forme de tyrannie contrôlerait, à la soviétique, la distribution des ressources matérielles, les comportements et les discours. Le tout serait supervisé, selon Ibram Kendi, par un Department of Anti-racisme (DOA), composé d’experts aux pouvoirs quasi illimités, une sorte de 4ème branche du pouvoir, n’ayant pas de comptes à rendre aux électeurs.
A lire aussi : Afrique du Sud : sale temps pour la nation arc-en-ciel ?
La stratégie contre-révolutionnaire que propose Christopher Rufo
La grande vulnérabilité de la révolution culturelle américaine réside dans le fait qu’elle vit sous perfusion de financements publics. La tâche la plus urgente pour ses adversaires est d’exposer la nature de l’idéologie, la manière dont elle opère et monter un plan pour riposter et l’abolir par un processus démocratique. Ils doivent camper sur la brèche creusée entre les abstractions utopiques de la révolution culturelle et ses échecs concrets, élaborer une stratégie visant à libérer les institutions de son influence et protéger le citoyen ordinaire de valeurs imposées d’en haut. Il leur faut soumettre le régime actuel à des tests simples : les conditions de vie se sont-elles améliorées ou détériorées ? Les villes sont-elles plus sûres ? Les enfants savent-ils lire ?…
Au lieu de libérer le militant noir de son complexe d’infériorité et de son désespoir, la révolution raciale l’a enfoncé dans cet état psychologique. Les théories critiques, comme idéologie dominante, risquent de conduire les États-Unis dans un cercle vicieux d’échec, de cynisme et de désespoir. Les théoriciens critiques qui revendiquent la représentation des opprimés, ne sont en fait qu’une classe bureaucratique entièrement protégée des contraintes du secteur privé. « Ils pensent être les intellectuels organiques à la Gramsci alors qu’ils ne sont que des tigres de papier ». Ils devront finir par se confronter à des questions difficiles. Qu’ont-ils à offrir aux opprimés ?
Les professeurs d’Harvard, Columbia et UCLA ne sont pas des guerriers. Ils ne menacent pas le système, ils en dépendent. Si le ressentiment est utile pour obtenir le pouvoir, il ne l’est pas pour l’exercer utilement. Ce qui laisse un espace pour affronter la révolution sur son terrain avec une force au moins égale et la vaincre politiquement. La contre-révolution doit commencer par redonner du sens aux souhaits basiques des Américains. Elle doit être une force positive visant à restaurer ce qui a été démoli. Pour y parvenir, il lui faut faire le siège des institutions qui ont perdu la confiance du public. Son but n’est pas de contrôler l’appareil bureaucratique mais de le briser. Pour réussir, les architectes de la contre-révolution doivent développer un nouveau vocabulaire politique capable de percer le récit racialiste bureaucratique. Pour ce faire, il leur faut puiser dans le réservoir du sentiment populaire afin de recueillir un soutien massif et construire ainsi des politiques qui coupent tout lien entre les idéologies critiques et le pouvoir administratif. La contre-révolution doit armer la population d’un ensemble de valeurs, exprimé dans un langage qui dépasse les euphémismes idéologiques actuels, et restaurer un sens de l’histoire plus sain qui inspire au lieu de faire honte. Le conflit le plus profond n’est pas un conflit de classes, de races ou d’identités mais une opposition entre les institutions d’élite et le citoyen ordinaire. La contre-révolution doit éclairer ce dernier sur le nihilisme qui menace de l’ensevelir et contribuer à restaurer le rôle de l’exécutif, du législatif et du judiciaire au détriment de l’ingénierie sociale qui sévit aujourd’hui.
Christopher F. Rufo, America’s Cultural Revolution: How the Radical Left Conquered Everything (Broadside Books, 2023), 352pp, 29,28€
Source: Le blog de Michèle Tribalat
America's Cultural Revolution: How the Radical Left Conquered Everything
Price: ---
0 used & new available from
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !






