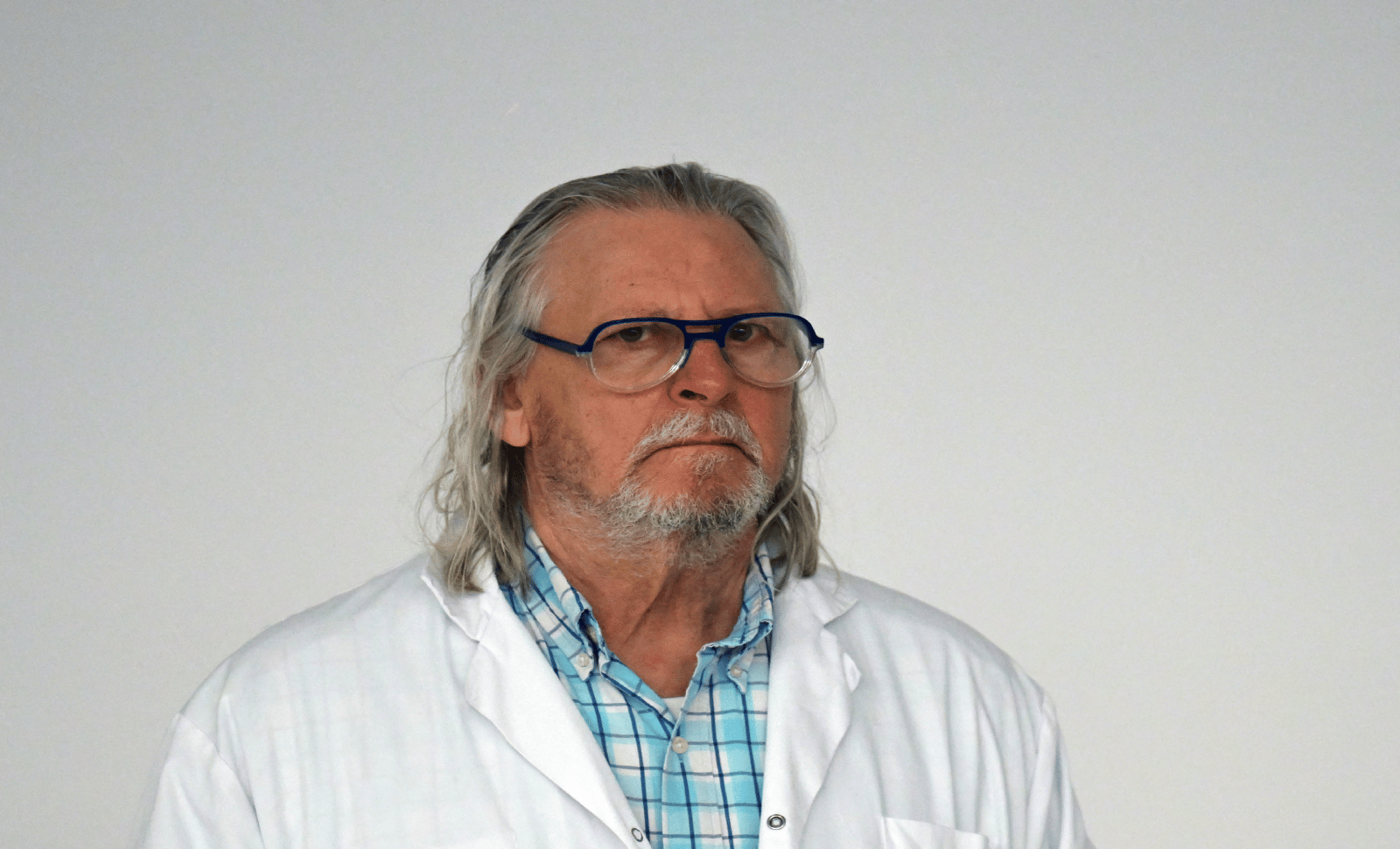La bonne santé n’est plus un privilège de riche. Dans les pays occidentaux, l’espérance de vie dégringole. Gestion technocratique de l’hôpital, hégémonie des lobbies pharmaceutiques, déshumanisation des soins sont autant d’erreurs stratégiques que notre système refuse d’admettre.
L’évolution de notre médecine prête à une réflexion approfondie. Jusqu’à un passé récent, l’amélioration de la qualité des soins et de l’espérance de vie étaient corrélées à l’augmentation du niveau de vie et des dépenses de santé. Depuis quelques années, ce n’est plus le cas. À partir d’un PIB de 20 000 dollars par tête d’habitant ou de dépenses annuelles de 10 000 dollars par habitant par an dans le domaine de la santé et de l’espérance de vie, il n’y a plus de corrélation claire entre les montants dépensés et la qualité des soins. Autrement dit, il ne sert à rien de dépenser de plus en plus d’argent. La question qui se pose est : comment utiliser au mieux l’argent consacré à la santé ? Chez nous comme dans beaucoup de pays d’Europe, les décisions ont consisté à diminuer le nombre de médecins. En France, nous sommes passés de près de 9 000 médecins formés par an dans les années 1970 à 3 500 par an dans les années 1990. La justification de ce choix était la nécessité de réduire les dépenses de santé. Or, elles n’ont fait qu’augmenter. Pas à cause de la croissance démographique, ni du vieillissement, mais parce que la France est l’un des pays riches où il y a le moins de médecins par habitant – un désert médical en dehors des villes et une population médicale vieillie, composée de baby-boomers. Heureusement, en dépit de cette situation née des décisions de technocrates, il y a toujours des gens pour se révolter. En effet, les étudiants qui veulent réellement étudier la médecine (et qui en ont les moyens) vont le faire dans d’autres pays d’Europe. Il y a, actuellement, 2 000 étudiants en médecine français en Roumanie, où on les forme en français. Il y en a au Portugal, en Belgique et ce phénomène va se développer, pour les médecins comme pour les autres métiers de santé dont l’effectif a été fixé artificiellement, sur la base d’une prédiction des besoins, qui comme la plupart des prédictions ne se réalise jamais.
Par ailleurs, la baisse du temps de travail, liée à la féminisation de la profession et à l’évolution générale de la société, a entraîné une réduction du temps moyen annuel de travail des médecins. Or, ces données n’ont pas été prises en compte par les modèles. De plus, cette diminution de temps médical disponible a été aggravée par l’accumulation des tâches administratives et réglementaires. En conséquence, pour les soins banals mais urgents, les patients se dirigent vers les urgences qui sont totalement saturées. Avec la crise Covid, la réponse actuelle à cette saturation a été de mettre en place des liaisons téléphoniques (avec le SAMU) où on conseillait plus ou moins fréquemment au patient de rester chez lui avec du Doliprane – la recommandation du directeur général de la santé au début de l’épidémie de Covid.
A lire aussi: Esprit de la science, es-tu là?
La grande nouveauté est que le numerus clausus ne sera plus défini au niveau national, il sera défini au niveau régional. Cette conception technocratique des besoins du pays va de pair avec la conviction que nous n’avons plus réellement besoin d’humains pour gérer la médecine. On a pu l’observer au cours de la crise du Covid, le directeur général de la santé, le professeur Salomon, conseillant aux gens de rester chez eux avec du paracétamol tandis que la politique thérapeutique se résumait peu ou prou à restreindre l’usage de tous les produits anodins qui pouvaient agir sur le Covid sans jamais se donner les moyens de les évaluer.
Ainsi donc, la partie majeure de l’investissement moderne va à des emplois non directement liés à la santé. Pendant ce temps, nous manquons cruellement d’infirmières et de médecins. Malgré le chômage qui continue à sévir en France, nous devons faire appel à des étrangers pour combler les trous de notre système de formation. On peut faire des observations du même ordre à propos du financement des hôpitaux – dont la gestion est d’autant plus désastreuse qu’ils sont plus grands, à en croire la Cour des comptes – et au sujet de l’achat de médicaments très coûteux dont l’utilité n’a jamais été démontrée et l’évaluation incomplètement réalisée.
Nous vivons une ère de déshumanisation, qui touche de nombreux domaines. En médecine, elle se voit dans le pari tout à fait extraordinaire que, grâce à de nouveaux médicaments actifs (dont il existe très peu d’exemples répondant à un besoin thérapeutique du xxie siècle) et à de l’information digitale, nous pourrons nous passer de médecins et atteindre les longévités extrêmes prédites par le transhumanisme.
La réalité est pénible – et têtue. Les pays les plus riches (en particulier dans les mégapoles : Paris, Londres, New York) sont ceux qui ont le plus souffert du Covid. La situation la plus significative est celle des États-Unis qui nous précèdent souvent dans les stratégies évolutives. Depuis plusieurs années, l’espérance de vie se dégrade aux États-Unis. Parmi les principaux facteurs de cette dégradation, beaucoup sont liés à l’obésité, contre laquelle il n’y a pas de lutte réellement organisée, au contraire : les objectifs sociaux et bienveillants interdisent la stigmatisation de ce qui est pourtant une maladie grave. Il faut aussi mentionner l’épidémie d’usage des dérivés de l’opium, propagée par l’industrie pharmaceutique (d’où le scandale de l’Oxycontin) et par les recommandations hospitalières de soulager immédiatement toute douleur, y compris la plus banale, qui entraînent une escalade dans l’usage des opiacés. Ceux-ci sont aussi détournés vers des usages récréatifs et sont devenus avec l’obésité une des causes majeures de la mortalité américaine.

Ces tendances, à l’œuvre depuis plusieurs années, se sont accélérées avec la gestion approximative de la crise Covid dans les villes les plus riches. C’est ainsi que, fin 2021, l’espérance de vie des Américains a régressé à 75 ans. Cette chute de quatre ans au cours des deux dernières années place les États-Unis entre la 70e et la 100e place mondiale, en dépit du fait qu’ils dépensent plus d’argent par habitant pour la santé que n’importe quel pays. Quel retournement de l’histoire de voir que l’espérance de vie aux États-Unis est bien plus basse que celle de Cuba qui au contraire forme un nombre de médecins considérable, ce qui lui permet de pratiquer une médecine de proximité, mais qui n’a pas les moyens de se payer les nouveaux médicaments remplaçant les anciens (qui marchent très bien). Par ailleurs, l’Algérie et les pays du Maghreb ont une espérance de vie qui est actuellement du même niveau que les États-Unis, ce qui montre la rapidité d’évolution, quand les choix sont mauvais.
Se pose donc une question claire : à notre niveau de connaissance et avec le capital de molécules que nous maîtrisons et possédons, peut-on en conclure que ce sont la recherche pharmaceutique et la mise au point de nouveaux médicaments qui ont une chance d’augmenter l’espérance de vie ? Ou faut-il plutôt développer les recommandations sur la qualité de vie, en commençant par s’attaquer aux problèmes émergents comme l’obésité massive ou la consommation massive d’antidouleurs ? Une quantité de thérapeutiques échappant aux normes de l’industrie pharmaceutique ont été et sont encore utilisés dans le monde pour soigner les gens. Rappelons que l’espérance de vie au Kerala (74 ans) est probablement du même niveau que celle des États-Unis, sans que l’on y recoure à des stratégies thérapeutiques sophistiquées et issues du XXIe siècle. Le problème, c’est que l’industrie pharmaceutique est le domaine le plus rentable du monde, en particulier dans les pays occidentaux, avec la littérature scientifique. Les deux secteurs, qui partagent d’ailleurs les mêmes investisseurs, dégagent des marges bénéficiaires extraordinaires.
Pfizer, le grand vainqueur financier de l’épidémie de Covid, a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 81 milliards de dollars, dont 34 milliards de dollars pour son vaccin. Ce montant est supérieur au PIB de nombreux pays. En 2021, les vaccins anti-Covid (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ont coûté 57 milliards de dollars. Autant dire que les enjeux financiers sont absolument colossaux et que la plupart des démocraties n’ont pas les moyens de lutter contre des puissances financières de cette taille. Or, la capacité des lobbies pharmaceutiques à influencer les stratégies thérapeutiques est beaucoup plus grande si les recommandations sont centralisées que s’il s’agit de convaincre individuellement chacun des praticiens. En conséquence, si nous continuons sur cette pente, la liberté des praticiens ira en diminuant. Et des officines telles que « No FakeMed », largement financées par l’industrie pharmaceutique, contribuent à cette mise sous tutelle, en décourageant le recours à des produits génériques et à des médicaments qui disparaissent de la pharmacopée pour promouvoir les produits de substitution.
A lire aussi: Dr Véran et Mr Covid
Les crises et l’observation comparée dans le temps et dans l’espace permettent de sortir d’une vision myope et purement française des besoins médicaux. Aussi longtemps que l’on remonte dans l’histoire de l’humanité, il y a toujours eu des formes de soins – partout dans le monde, des formes de médecine, ainsi que l’aurait dit Ambroise Paré : guérir parfois, soulager souvent, soigner toujours. Cette réflexion sur le soin est toujours d’actualité. Il est bien évident qu’un certain nombre de thérapeutiques ont un effet « placebo », c’est-à-dire que leur efficacité repose sur l’activation de certaines zones cérébrales et non pas sur une action directe. Ces phénomènes sont de mieux en mieux connus et permettront sans doute à l’avenir de mieux clarifier les effets thérapeutiques dont nous ne comprenons pas aujourd’hui le mécanisme d’action.
D’autre part, notre modèle du progrès, fondé sur l’observation des États-Unis, est aujourd’hui en faillite. Nous assistons à un retournement de situation dans lequel les champions du progrès et de la maternité plongent, malgré des dépenses colossales, dans une régression sans précédents notables. Si cette crise n’aboutit pas à remettre en question notre fuite en avant dans l’innovation pharmaceutique, qui contribue de façon extrêmement mineure à l’espérance de vie sans permettre de lutter contre les véritables problèmes de qualité de vie et pour des recommandations raisonnables, nous suivrons comme d’habitude l’exemple des États-Unis.
Il faut repenser nos modèles. L’évolution, en particulier celle des humains, se fait beaucoup par imitation de ceux qui ont plus de succès. Aussi, le retournement actuel doit-il nous amener à revisiter le mode de développement de notre civilisation. Quand les pays pauvres communistes, ou proches des communistes, ont une espérance de vie qui est supérieure à celle du leader mondial du XXe siècle (États-Unis), on ne peut pas faire l’économie d’une telle réflexion. La course en avant pharmaceutique et la mise sur le marché de produits qui atteignent des prix défiant l’entendement éliminent pour obsolescence les molécules les plus anciennes qui deviennent impossibles à trouver ou sont interdites de prescription : elle n’est justifiée que par les résultats économiques. La puissance des acteurs économiques actuels est telle qu’il faut de nouvelles règles et de nouvelles lois pour limiter leur influence devenue excessive. Au nom d’une recherche, dont les bénéfices sur la longévité restent à démontrer, nous avons ouvert une très large porte aux conflits d’intérêts, dont les acteurs ne sont pas même conscients, aveuglés qu’ils sont par l’idéologie du progrès pharmaceutique considéré comme une évidence. En pratique, on continuera à avoir besoin de médecins, de praticiens, de la physiothérapie, d’infirmières, de soins de proximité, d’écoute.
L’idée que ces problèmes se régleront dans des réunions de technocrates, qui empêchent les gens de pratiquer un des métiers les plus essentiels de l’humanité, n’est pas raisonnable. Le modèle de développement de la santé n’est plus réaliste. Les mesures de Santé Publique France sont souvent des diversions pour ne pas faire face aux problèmes réels : le plus important, dans les pays développés, est précisément celui de la consommation de boissons sucrées. Après la consommation directe de tabac, c’est la plus grande urgence. Ainsi, je redoute les foudres de No FakeMed, qui n’a d’ailleurs pas cessé de me persécuter, quand je recommande de regarder un peu du côté de la médecine ayurvédique au Kerala, qui donne des résultats si étonnants, des massages traditionnels thaïlandais pratiqués dans les hôpitaux, de l’acupuncture en Chine. Bref, arrêtons de croire que c’est seulement de l’industrie américaine et anglaise que viendra le salut sur l’état général de la population.