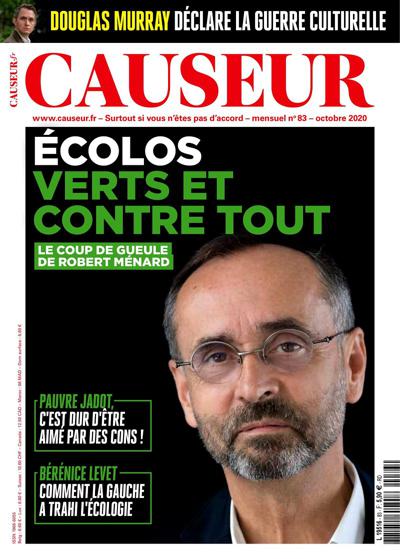Les quotas de diversité, sous l’impulsion de France télévisions et du Centre national du cinéma, sont en train d’asphyxier la créativité au cinéma. Il n’y aura bientôt plus que des scénarios écrits en fonction des minorités à représenter. Et le secteur ne comptera plus aucun mâle blanc hétéro dans ses rangs.
Des hommes en trop. Ce n’est pas le titre d’un film, mais la chronique, qui risque bien de devenir ordinaire, de la vie des réalisateurs français. Dans le cadre de la campagne promotionnelle de leur dernier film, Effacer l’historique, les cinéastes Gustave Kerven et Benoît Delépine accordaient un entretien à l’hebdomadaire Marianne. « Un tel film est-il facile à produire ? » leur demande le journaliste. Le film est une comédie, les acteurs sont populaires, nos budgets sont limités, la chose est donc aisée, répond en substance Kerven. Intervient alors Delépine qui, sans crainte, met les pieds dans le plat : « On a quand même failli subir un gros problème puisqu’une chaîne de télévision associée à la production a retiré sa participation quinze jours avant le tournage. — Pour quelles raisons ? interroge le critique. — Parce que nous ne sommes pas des réalisatrices… La chaîne avait des quotas à respecter et on se retrouvait en trop dans le camp des mâles. » Des mâles blancs de plus de 50 ans, aurait pu ajouter le réalisateur, car eussent-ils été noirs, homosexuels et jeunes, le verdict eût changé du tout au tout.
Une chaîne de télévision et des quotas à respecter ? Le doute n’est guère permis. Sans conteste, il s’agit de France Télévisions. En novembre 2018, Delphine Ernotte, la présidente du groupe, annonçait pour 2020 l’instauration de « quotas pour les femmes réalisatrices ». Or, il faut savoir que la « France compte le plus grand nombre de réalisatrices de longs métrages en Europe » et que « les projets déposés par les femmes sont plus souvent soutenus que ceux déposés par les hommes » par la commission de l’avance sur recette du Centre national du cinéma. Ces données ont été rendues publiques lors d’une table ronde organisée par le CNC lui-même en avril 2018, intitulée « Femmes et cinéma : la relève ». Quelle conclusion en était tirée ? Non que le combat était gagné, mais qu’il fallait plus que jamais « continuer à agir ». L’objectif est donc explicite : le mot « relève » est à entendre en son sens le plus fort, celui de – on s’y risquera – « grand remplacement », et très exactement de destitution des hommes par les femmes.

de François Truffaut (1977). ©Everett / Bridgeman images
Les femmes ne sont pas les seules bénéficiaires de la conversion de la France à l’empire des identités. Les contrats de production de France Télévisions incluent d’ailleurs une « clause de la diversité ». Du reste, quota ou non, France Télévisions ou non, ces nouvelles objurgations font loi. Et sont dans toutes les têtes. On a beaucoup glosé sur les cinq « critères de diversité » établis par l’académie des Oscars et dont le respect conditionnera l’éligibilité d’un long métrage à l’Oscar du meilleur film à partir de 2024. Mais c’est un faux débat. La sélection a déjà largement lieu en amont. Dès le moment de l’écriture, pour être assuré de trouver le financement nécessaire à la réalisation, le scénariste risque bien d’être tenté d’assaisonner son long métrage de X % de minorités ethniques sous représentées, X % de femmes, etc.
Que va-t-il advenir du 7e art français, déjà bien mal en point ? Que deviendront, dans ce contexte, des films de tradition française qui avaient l’heur, et la saveur, de tout ignorer du politiquement correct ? Et d’ailleurs, si ces films conspués par la Nouvelle Vague sont plus que jamais plébiscités par les Français, ce n’est pas, ou pas seulement, par nostalgie pour les temps qui les ont vus naître, mais parce qu’ils étaient vrais, parce que l’humaine nature s’y incarnait, parce que les dialogues n’y étaient pas encore écrits sous la surveillance des bureaux d’esprit féminins, décoloniaux, LGBT+, etc. Bref, parce qu’un vent de liberté y soufflait, infiniment revigorant pour nous qui étouffons sous le poids de toutes ces convenances.
Une œuvre d’art n’est pas un test de moralité. Elle est un instrument de perception, mais non pour voir des Noirs ou des femmes, mais explorer, sonder l’humaine condition dans son universalité. Sa vertu est d’élargir notre être, non de nous enfermer dans le cercle étroit des identités. Le seul critère que nous devons avoir en tête pour juger d’une œuvre n’est ni le sexe, ni la sexualité, ni la couleur de peau du réalisateur ou des interprètes, mais sa puissance de révélation, sa capacité à porter le flambeau dans des coins inexplorés ou inaperçus de la réalité. « Une grande philosophie, écrivait Charles Péguy, n’est pas celle où il n’y a rien à reprendre. C’est celle qui a pris quelque chose. » Cela vaut pour la littérature, la peinture, le cinéma. Dès lors qu’il y a « prise », une œuvre est légitime et ce, quelle que soit la vie de son auteur, ses tribulations, ses « péchés », ses « fautes ». C’est bien pourquoi, il faut le marteler, aussi longtemps que Roman Polanski ou Woody Allen « prendront » quelque chose, ils seront incontestables. Et ce fut éminemment le cas avec J’accuse, il est donc légitime que nous soyons reconnaissants envers Polanski.
Pour qu’il y ait prise, il faut que l’artiste demeure un témoin de la liberté, c’est-à-dire, ainsi que l’a si bien établi Albert Camus, un témoin et un exemple de ce pas de côté que l’homme peut toujours accomplir par rapport à l’histoire, par rapport à l’actualité et aux maîtres de l’heure. Cette liberté est fragile. Elle demande des esprits forts et des âmes jalouses des prérogatives de leur art. À l’image de François Truffaut qui, en 1977, réalise L’homme qui aimait les femmes, sans rien ignorer de « l’atmosphère servilement féministe » selon ses propres mots, dans laquelle baigne la France des années 1970, mais bien résolu à ne pas plier. Digne héritier de Gautier ou de Flaubert qui, au xixe siècle, comprennent que ce serait désormais devant le tribunal des Homais et de la société que les œuvres seraient appelées à comparaître, C’est cet esprit frondeur qui fait cruellement défaut aujourd’hui. Loin de braver l’air du temps, dans leur grande majorité les réalisateurs et acteurs (le masculin est à entendre ici en son acception générique) semblent n’avoir rien de plus pressé que de donner des gages de leur appartenance au camp du Bien en déclinant la cause que servirait le film qu’ils ont réalisé ou dans lequel ils jouent. Tous les arts sont atteints. Hier, le peintre peignait un arbre avec pour seul souci d’être capable d’en faire « sentir l’écorce », à la manière de Constable ou de Lucian Freud ; aujourd’hui, lorsqu’il peint un arbre, c’est un « arbre pour le climat » et la COP 21. Jamais le mot de Camus n’a été plus vrai : « Dans un monde qui ne croit plus au péché mais qui s’intoxique de morale abstraite, l’artiste a voulu se charger de la prédication. » Est-il toutefois téméraire, voire naïf au regard de leur actuelle docilité, de penser que les artistes finiront par être eux-mêmes las de cette réquisition perpétuelle ? À l’exemple de l’actrice Sandrine Bonnaire, invitée le 11 août dernier de la matinale de France Inter pour le film Voir le jour, réalisé par Marion Laine, et dans lequel elle interprète le rôle d’une puéricultrice. Très vite, la journaliste, Carine Bécard en vient à la question, qui n’en est pas une d’ailleurs, nouveau point Godwin de tout entretien : « C’est un film très féministe. » Un silence. Puis la réponse de Bonnaire : « J’ai un peu de mal avec le féminisme […] On dit “c’est un film féministe” parce qu’il y a beaucoup de femmes… » Avec cette bonne conscience invincible au doute, la journaliste s’étonne de la résistance que l’interprète de Pialat et de Varda lui oppose. Elle s’obstine. Alors, impatientée, mais souveraine, l’actrice fait résonner le clap de fin : « C’est une conversation qui ne m’intéresse pas. — Je le vois, on va passer à autre chose. — S’il vous plaît. » Bonnaire comprenait que du film, de l’histoire singulière qu’il racontait et dont elle était venue parler ce matin-là, il ne resterait rien. La journaliste avait trouvé le moyen de s’en débarrasser en l’étiquetant « film féministe ».