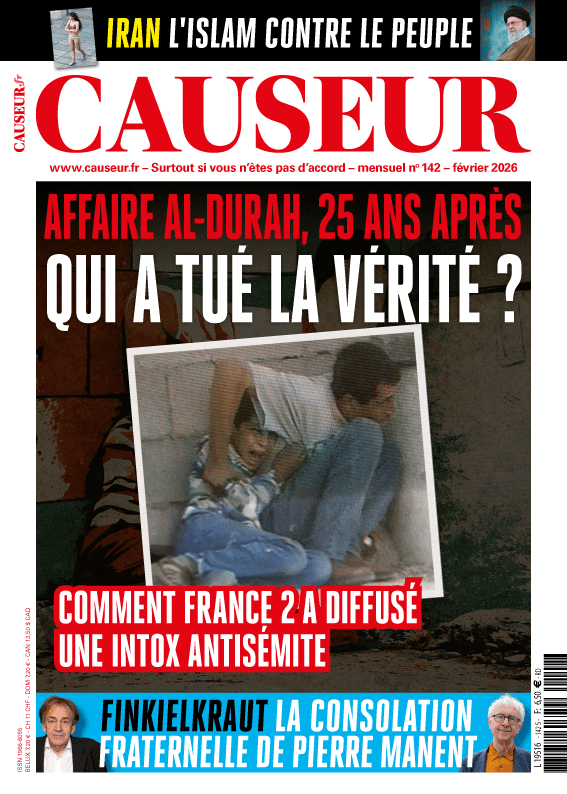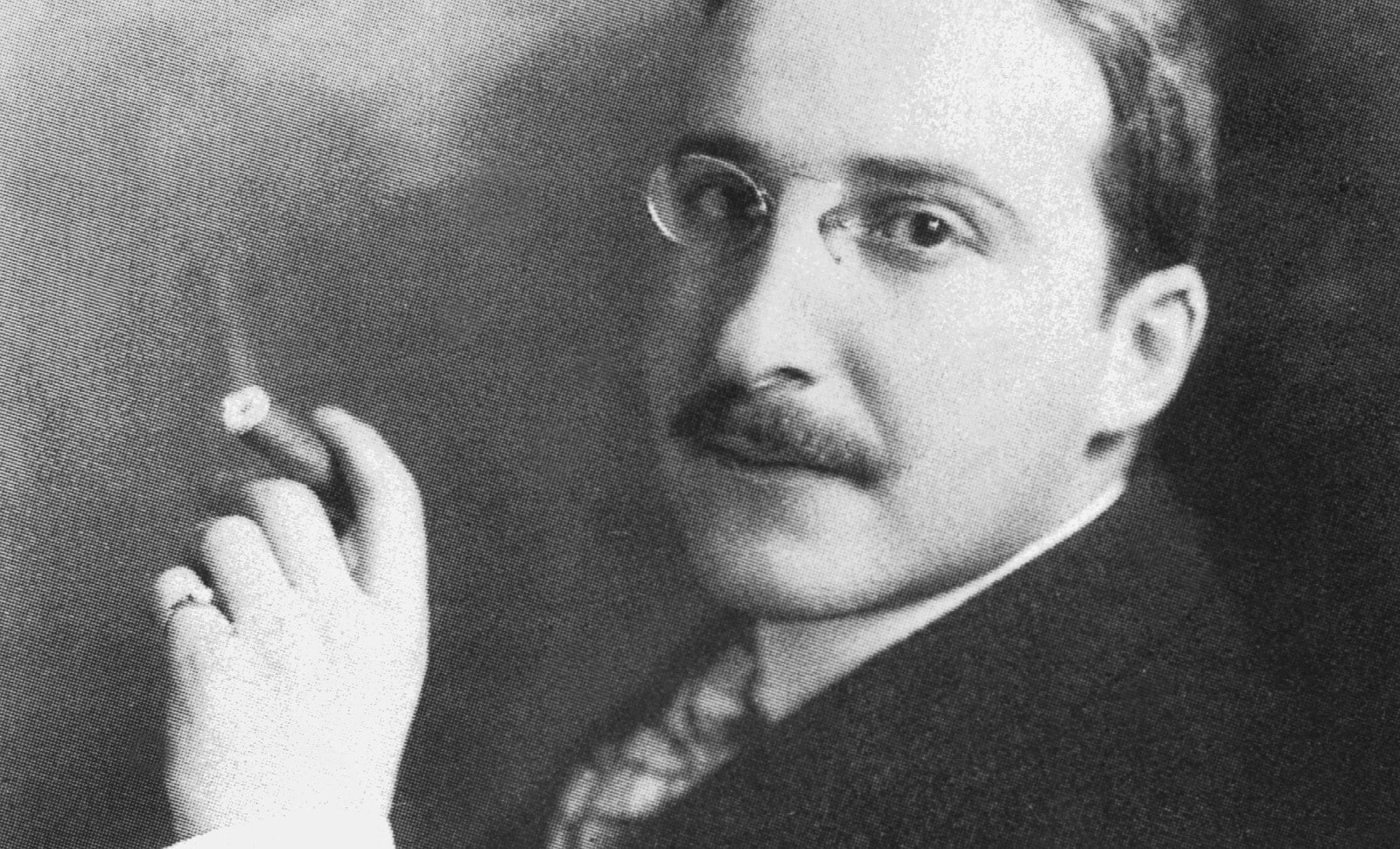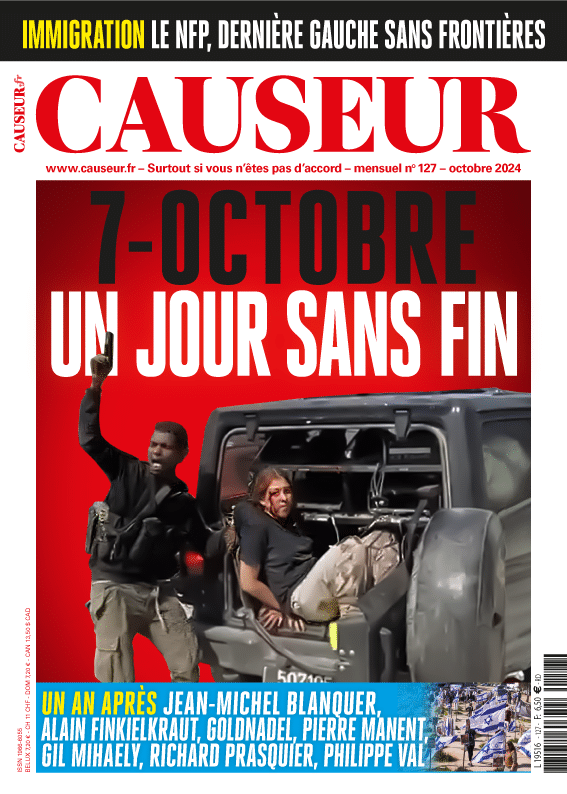La culture européenne existe-t-elle encore ? La question, qui divise aujourd’hui les intellectuels, est ignorée par nos élites. Cette culture a pourtant forgé notre regard et un « esprit européen » que le monde entier a admiré. Mais de renoncements en reniements, notre civilisation semble admettre son effacement.
Il n’a guère été question, lors des dernières élections européennes, de l’Europe culturelle dont la préservation mobilisa les plus grands esprits du XXe siècle, qui jetèrent leurs forces dans ce combat délaissé par les nouvelles « élites », mais pas par les peuples. La culture, que le monde entier enviait jadis à l’Europe, n’est pas seulement conservée dans les musées ou les édifices publics et privés. C’est aussi « une certaine manière de considérer le monde, assimilable à un pli de la pensée ou à un regard », foncièrement irrévérencieux selon Chantal Delsol[1]. On ne relira donc jamais assez Stefan Zweig[2] (1881-1942) dont les articles combatifs, publiés entre 1909 et 1941 dans la presse germanophone, viennent d’être édités en français sous un titre évocateur (Mélancolie de l’Europe, Plon, 2024). Mais l’Europe en proie au reniement de soi et tentée par un « étrange suicide » (Douglas Murray[3]) est-elle encore capable d’être mélancolique en se souvenant de ce qu’elle fut ? Or, c’est justement la culture qui permettrait à cette remémoration d’être un tremplin vers le futur.
Un colloque à Genève en 1946
Stephan Zweig ne fut pas le seul à alerter les Européens dont les deux guerres mondiales avaient ébranlé les certitudes, au point qu’il leur fallut, après la catastrophe, réfléchir ensemble sur ce qu’est l’« esprit européen ». Cela se passa dans un colloque qui se tint en 1946 à Genève, et réunit des penseurs aussi différents que Georges Bernanos, Denis de Rougemont et Georg Lukács. Qui imaginerait pareille rencontre aujourd’hui ? Le défi était à l’époque de mobiliser les forces de l’esprit contre une possible rechute dans la barbarie, et de promouvoir un « idéal de fraternité transnationale » (Zweig) qui écarterait le péril nucléaire omniprésent dans les esprits après Hiroshima et Nagasaki. Et c’est pour avoir été le théâtre d’une « déchéance incroyable de la culture » (Thomas Mann) que l’Europe était appelée à être le foyer de son renouveau. Car une faiblesse assumée peut devenir le meilleur remède contre la déchéance, comme l’a montré Edgar Morin dans un essai incontournable et plus que jamais d’actualité (Penser l’Europe, 1987). Mais une Europe qui renonce à sa culture peut-elle encore avoir conscience qu’une « communauté de destin » unit pour le meilleur et pour le pire les peuples européens ?
A lire aussi, Georgia Ray: École: ce n’est plus le Moyen Âge!
Or de Nietzsche à Peter Sloterdijk rappelant que l’Europe est « le continent-mère de la modernité » (Si l’Europe s’éveille, 2003), le spectre de la décadence, fruit du nihilisme lui aussi européen, hanta les meilleurs esprits qui savaient cependant encore nommer l’ennemi, extérieur ou intérieur, que la culture avait pour vocation de civiliser ou de repousser : le nazisme, le bolchevisme, la démagogie, le défaitisme. C’est dans cet esprit que Thomas Mann lança en 1937 son Avertissement à l’Europe, que María Zambrano rédigea durant son exil L’Agonie de l’Europe (1945), et que Jan Patočka écrivit les textes réunis dans L’Europe après l’Europe (traduction française en 2007). À supposer que le « soin de l’âme » ait été depuis Platon la préoccupation majeure de l’Europe culturelle et spirituelle – nourrie au moins autant que déstabilisée par son inquiétude –, qui désormais s’en soucie alors que la gestion du « soin » est devenue une industrie ?
On peut, il est vrai, réfuter l’idée même de « culture européenne » au nom des cultures nationales et régionales, seules existantes en fait, ou parce qu’on la suspecte de reproduire à grande échelle les réflexes identitaires dont on déplore les effets pervers quand ils sont ceux des individus ou des peuples. Aussi l’unité culturelle de l’Europe ne serait-elle envisageable qu’en tant que complexité « dont le propre est d’assembler sans les confondre les plus grandes diversités et d’associer les contraires de façon non séparable » (Edgar Morin). Méfiant à l’endroit d’une « identité culturelle » européenne difficilement identifiable et de surcroît « terriblement réductrice et paresseuse », François Jullien l’évince habilement au profit des « ressources » mises par chaque culture à la disposition de qui veut les faire fructifier[4] ; l’Europe, individualiste mais éprise d’universalité, étant à cet égard particulièrement riche en possibilités offertes à l’humanité. C’est un peu vite oublier que le risque n’est plus alors le « repli sur soi » identitaire, mais la transformation de l’Europe culturelle en grenier à blé où tout le monde a le droit de puiser, sans respect ni égards obligés pour ceux qui ont contribué à créer et préserver ces ressources.
Dynamique
On ne conjurera donc les menaces bien réelles qui pèsent aujourd’hui sur l’Europe culturelle – affaiblissement, ensauvagement, asservissement – sans remonter aux sources de son malaise qui ne date pas d’hier, et qui est partie prenante de l’« esprit européen » dont Jean-François Mattéi écrivait : « L’originalité du regard de l’Europe tient à ce combat qui la dresse contre elle-même dans une volonté irrésistible de dépassement[5]. » Dépassement de quoi si on a perdu le sens de l’orientation qui permet d’entrevoir un horizon ? Et si l’Europe ne cesse en ce sens d’agoniser (du grec agon, compétition, lutte), ce peut être aussi bien parce qu’elle s’inflige des épreuves inutiles qui ne peuvent la grandir, ou parce qu’elle est malgré tout encore capable d’intégrer et de transformer ce qui menaçait de la détruire. Aussi les Européens ne peuvent-ils plus se contenter de faire appel à « l’éternelle solidarité de l’esprit créateur », comme le fit en son temps Stefan Zweig, sans remettre en marche cette dynamique créatrice qu’est la culture.
Le Regard vide: Essai sur l'épuisement de la culture européenne
Price: ---
0 used & new available from
[1] L’Irrévérence : essai sur l’esprit européen, La Table Ronde, 2013.
[2] On pense en particulier au Monde d’hier : souvenirs d’un Européen. (1943), traduit en français en 1948, Appels aux Européens et à L’Esprit européen en exil (1933-1942).
[3] L’Étrange suicide de l’Europe, L’Artilleur, 2018.
[4] Il n’y a pas d’identité culturelle, L’Herne, 2016.
[5] Le Regard vide : essai sur l’épuisement de la culture européenne, Fayard, 2007, p. 28.