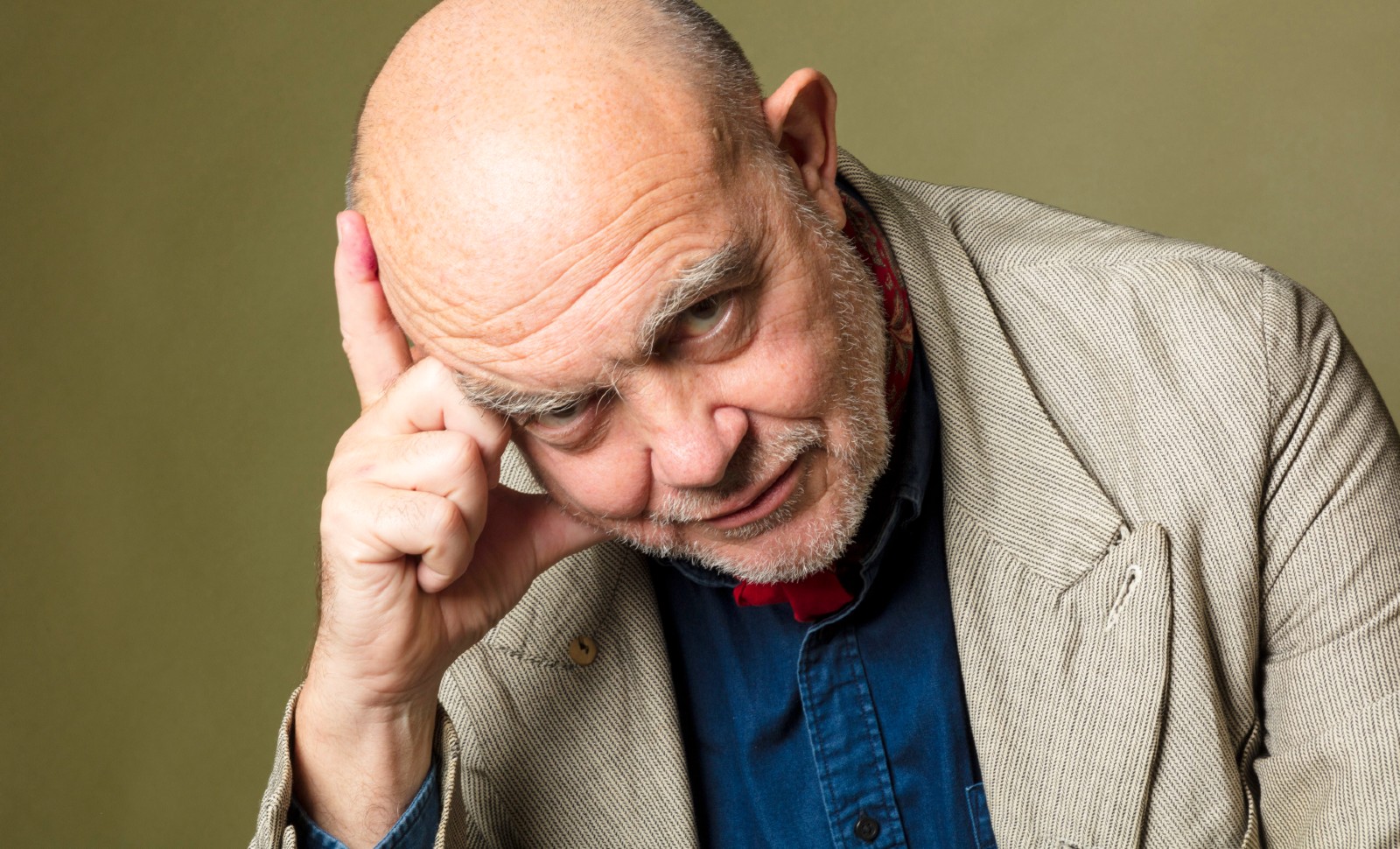Après avoir marqué de son nom le monde de la haute couture, Christian Lacroix l’a imposé à l’univers du décor et du costume de scène, à l’opéra et au théâtre. Il a récemment signé sa première mise en scène d’opéra avec La Vie parisienne d’Offenbach, empreinte de rêve et de nostalgie. Entretien avec un créateur de génie. Propos recueillis par Yannis Ezziadi.
Causeur. Lorsque l’on regarde votre travail ou que l’on écoute vos interviews, la nostalgie paraît très présente. Cette nostalgie, ce passé rêvé sont-ils un moteur pour vous ?
Christian Lacroix. Oui, je dois dire que je fonctionne beaucoup à partir du passé, que j’ai longtemps préféré le rétroviseur. Mais comme le dit joliment le titre du livre de Simone Signoret – que je n’ai pas lu ! –, « la nostalgie n’est plus ce qu’elle était ». C’est d’ailleurs une bizarre alchimie qui ne fonctionne que jusqu’à un certain âge et ne se porte que sur les vingt ou trente premières années de notre vie, sinon les dix premières seulement, celles où tout se décide, se forme, s’enregistre. Et c’est beaucoup sur cette banque d’images, constituée très tôt dans les vieux livres, albums, magazines, tableaux, gravures, musées, impressions, etc., que j’ai fonctionné et fonctionne encore aujourd’hui. J’ajouterai que, si je suis nostalgique des années 1960, je le suis encore davantage des décennies qui ont immédiatement précédé ma naissance et que je n’ai donc pas connues. Et contrairement à la jeune génération actuelle, je n’ai aucune nostalgie pour les années 1980-1990 que j’ai vécues sans grand enthousiasme.
Fantasmer des époques que vous n’avez pas connues, est-ce pour vous un moyen d’échapper à la réalité ?
Tout à fait, le temps et l’espace aussi, tout ce qui vient d’ailleurs, qui est exotique. Mais oui, ce refuge du « grenier » a longtemps été une façon d’échapper, sinon à la réalité, du moins au quotidien. J’ai toujours trouvé du sel, des pépites, des motifs de plaisir, de bonheur et de connaissance dans la réalité. Par contre, la routine manquait d’apparat, de sophistication, d’allure et je préférais les salles des musées, les livres d’art, les albums de photos anciennes à scruter comme pour traverser le miroir, telle Alice, suivre le fil rouge de tout ce qui pouvait m’être une sorte de machine à remonter le temps, me créant ainsi un espace-temps personnel. Mais la nature – dès que je m’éloignais d’Arles – ou les villes étrangères me donnaient aussi cette échappatoire, cet escapism comme disent les Anglais. Un jardin secret plein de « paradis perdus ».
A lire aussi : La nostalgie n’est plus ce qu’elle était…
Vous semblez trouver votre liberté de création tout en respectant des codes et des traditions. La tradition est-elle selon vous une chose importante pour avancer ou un carcan dans lequel il serait dangereux de s’enfermer ?
Je dois tromper mon monde alors, ou avoir une démarche plus complexe que cela, car je n’aime de la tradition et des codes que l’artifice, l’apparence, le spectacle, l’esthétique. J’en aime les mystères, les énigmes, ce qui m’est étranger par goût du « pittoresque », de l’« exotisme » justement. En revanche, pour moi, le fond, le dogme, les codes et les traditions sont des chapes de plomb, des carcans dont il faut se débarrasser. Ils sont faits pour être outrepassés par l’innovation, la créativité, l’invention, ce que l’on ne connaît pas encore. J’aime et respecte une forme de règles, de lois si elles sont sans cesse remises en question, en évolution, perfectibles chaque matin. J’aime quand le costume des Arlésiennes évolue, comme il l’a toujours fait, sans rester figé dans un moule artificiel, naphtalinisé où on voudrait le contraindre. Bien sûr, ce sont des démarches délicates, à l’opposé de toute édulcoration, simplification, abâtardissement. Ainsi je préfère le costume xixe au costume xxie, idem pour le torero, le costume goyesque, bien réinterprété, ce qui est rare, est plus beau que le traje de luz (l’« habit de lumière ») contemporain qui, bien que flamboyant encore, n’a plus rien à voir avec celui de la fin du xixe et du début du xxe. Quant à la tradition tauromachique je constate qu’elle me pose question aujourd’hui : comme la nostalgie, le mundillo et l’aficion ont bien changé.

Si je ne me trompe pas, votre époque préférée est celle de Cocteau et de Noailles. Pour quelles raisons ?
En effet, j’ai une prédilection particulière pour les années qui vont de l’immédiate avant-guerre (1937-1938) aux années 1960. Je suis toujours passé à côté des années 1920, du cubisme, du surréalisme, de l’art africain, du jazz, du dadaïsme, de l’Art déco. Rien de tout cela ne me parle. J’aime le post-modernisme, le néoclassicisme, Bérard, les frères Berman, le Poulenc de cette époque, les ballets de Roland Petit. Parce que c’est sans doute presque la dernière époque où ont pu coexister le meilleur du xixe et du début du xxe et l’avant-avant-garde, les « modernes », une époque où la culture et la fortune étaient le plus souvent dans les mêmes mains que l’innovation ou la création, la nouveauté. Sans doute les guerres ont-elles aussi exacerbé un certain escapism, une créativité et une poésie nées de l’instinct de survie. Tout cela avait de l’allure, de la gueule, des moyens d’aider les artistes, au-delà de la bienséance et de la moralité bourgeoise. C’était étonnant, détonnant et j’ai eu la chance de connaître un peu la queue d’une telle comète avec la présence de Cocteau et de Picasso à Arles, la rencontre plus tard à Paris de témoins de ce monde comme Boris Kochno ou le prince de Faucigny-Lucinge. Si ces années peuvent avoir aussi un côté boursouflé, comme certains chapeaux à la mode sous l’Occupation, elles sont aussi les dernières à avoir dicté le plus grand et joli goût français, du cinéma (Les Dames du bois de Boulogne) à la mode en passant par la littérature (Louise de Vilmorin), etc.
Quelles sont les caractéristiques de cette époque qui manqueraient cruellement à la nôtre ?
La liste serait trop longue. Disons la légèreté, la futilité, l’esprit, la drôlerie, le secret, l’onirisme, la gratuité, la conversation, la mondanité (pas des « people »), le « chic », le « flirt », tous ces mots démodés. Une façon aussi d’interpréter les codes, traditions, règles et lois évoqués plus haut en les détournant avec esprit, quitte à les compliquer. La langue française par exemple, l’orthographe que tant de gens souhaiteraient voir simplifier, je la compliquerais au contraire, avec force subjonctifs, loin de la seule phonétique. C’est ce qui en fait la grâce, l’élégance.
Comment décririez-vous la Camargue – votre région – et a-t-elle influencé l’artiste que vous êtes ?
Je suis provençal avant d’être camarguais. La Provence, c’est l’enfance, Fontvieille, le moulin de Daudet, la chèvre de Monsieur Seguin, les crèches à Noël et les costumes des santons, la langue drolatique des Arlésiens, les restes du xviiie et du classicisme antique, Pagnol, etc. L’enfance dans les Alpilles m’a sans doute plus marqué que celle passée aux Saintes-Maries-de-la-Mer. La Camargue, c’est plutôt l’adolescence, la plage à l’infini, la sensualité, les chevaux, un paysage d’aquarelle japonaise où on ne sait pas où finissent et où commencent l’eau, la terre, le ciel, la lumière, les mirages. C’est tout le contraire de la Provence, ce qui rend mes influences très complémentaires et paradoxales.
Vous sentez-vous créateur, créateur français, ou créateur camarguais ? Je pense notamment à Rudy Ricciotti qui se décrit comme « architecte maniériste et provençal » !
J’adore Rudy et son génie du verbe autant que de l’architecture. Arlésien certes, plus que français et bien plus que parisien, deux adjectifs dans lesquels je ne me suis jamais reconnu, encore moins aujourd’hui. Arlésien résume les deux : la Camargue et la Provence.
A lire aussi : Caubère et Daudet, la Provence à l’Œuvre
Pensez-vous que la disparition des costumes régionaux dise quelque chose de notre époque ?
La migration, le métissage, une forme de libération aussi quelquefois quand le costume régional est une obligation ou bien une contrainte. Il peut voyager aussi. Je me souviens, enfant, à la messe du dimanche à Arles, de deux amies, deux vieilles dames, l’une en costume savoyard avec sa coiffe en pointe « Médicis » et l’autre en Indochinoise avec son large ruban de velours entouré autour du crâne. Mais les filles d’Arles, si elles ne portent plus souvent le costume qui, au passage, les magnifie, ont leur manière de s’habiller et d’interpréter les modes. Il ne faut pas non plus que le régionalisme devienne sectaire. Je me souviens, enfant, de batailles (verbales) de vieilles dames selon leur quartier ou leur village, défendant leur idée personnelle du ruban d’Arlésienne, longueur, hauteur, forme des bandeaux de cheveux, etc.
Vous avez dessiné des tramways, des tenues pour les agents de la SNCF ou encore décoré des cinémas et des hôtels. Avez-vous la volonté à travers cela d’apporter la beauté dans le monde quotidien ?
J’ai adoré faire tout cela en effet, comme au théâtre, une façon de redessiner un monde à partager à partir de ce que je pouvais apporter en matière de formes et de couleurs, de style. (photo manquante, de Florie Valiquette, page 83)

Ne pensez-vous pas que l’importance de la beauté est trop souvent négligée ?
Vaste sujet. Je suis loin des écoles d’art, d’architecture, de design aujourd’hui et j’ignore comment on se retrouve chargé de la création d’un ensemble immobilier, d’un rond-point, d’un magasin ou d’un objet, mais force est de constater que je n’éprouve guère au jour le jour le sentiment pourtant recherché du choc, de l’inconnu, de la beauté innovante. Rues, ronds-points et décor quotidien sont plutôt affligeants et envahissants, ne serait-ce que par le biais de certaines émissions de cuisine ou de décoration, sans parler des blogs où l’horreur, la « hideur » font florès.
Assiste-t-on à ce que Rudy Ricciotti (encore une fois !) nomme « l’exil de la beauté » ?
Certainement. Il me faudrait davantage de temps pour y réfléchir. Car aujourd’hui, même certains métiers d’art, artisans, etc., produisent des œuvres qui me semblent privées de toute notion de beauté.
À la fin des années 1980, vous trouviez que la rue était devenue « triste et lourde » ? Que pensez-vous de la rue de 2022 ?
La rue est encore plus triste, car encore plus uniforme et atone. Mais je ne la critiquerai pas car elle est la devanture d’une précarité grandissante en plus de celle du peu de souci porté à la moindre recherche esthétique, au nom du confort, du bien-être, du sport et du clonage streetwear. Seuls les Africains apportent un style, même dans la pauvreté, une façon de conserver créativité, liberté, expression personnelle, allure, hiératisme.
Dans la rue, le survêtement et les baskets sont omniprésents. Est-ce la défaite de la sophistication et le triomphe du confort ?
Triomphe des marques, des réseaux sociaux, d’un luxe dévoyé qui hurle son prix et non sa créativité. Allure passe-muraille pratique pour les uns, affichage d’une certaine appartenance pour les autres avec tout un tas de « codes » abscons et éphémères en matière de sneakers, selon que l’on appartient à tel quartier, gang, courant musical. Le sport et la musique sont peut-être les nouveaux folklores représentatifs de certains groupes, tout comme les minorités qui se signalent par leur style propre, reconnaissable, LGBTQIA+, etc. La rue est tribale et cela me passionnerait de l’étudier plus attentivement. Elle génère sa/ses propres modes et les grandes marques les suivent bien plus qu’elles ne les précèdent.
A lire aussi : Calvin Klein baisse son caleçon devant la propagande woke
Vous dites que ce que vous aimez au théâtre, c’est que ce soit plus grand que la vie. Mais ne trouvez-vous pas que cela est aujourd’hui chose rare, et qu’au contraire le théâtre devient de plus en plus fréquemment un miroir de la vie non sublimée ? (Le costume de théâtre en fait d’ailleurs les frais : jean/baskets ou costard/cravate la plupart du temps).
Bien sûr. Je parle du théâtre de mon enfance et de mon adolescence, qui accordait encore une large part aux décors et aux costumes. Mais effectivement il y a un nouvel académisme issu du Regietheater allemand des années 1970-1980 qui fait peu cas, sinon aucun, de cela.
Vous avez participé à l’aventure de Phèdre, mise en scène par Anne Delbée et jouée par Martine Chevallier, à la Comédie-Française en 1996. Ce fut probablement l’un des plus grands spectacles tragiques de ces cinquante dernières années. Quels souvenirs en gardez-vous ?
Les diverses soirées, presque nuits entières, à écouter Anne disserter sur Racine et sur Phèdre comme si elle écrivait déjà le livre, somme qu’elle a publiée un peu plus tard. Les soirées, presque nuits aussi avec Renato Bianchi dans son bureau de la Comédie-Française dont il a été responsable des ateliers costumes des décennies durant. Le travail de psychologie de chacun lors des essayages, les sacrés liens tissés avec les acteurs, la munificence des tissus, des patines, des broderies artificielles, les kilomètres de traînes se croisant comme un nœud autoroutier lors de la première répétition, slalomant entre candélabres et carafes, verres de vin. Le rythme entêtant et hypnotique des alexandrins tels que voulus, dits, par Anne et ce premier Molière, un privilège. Je crois que nous avons tous été envoûtés par Anne et qu’elle nous a transmis ce feu, cette emphase, ce « plus grand que la vie » et que nous l’avons tous « exsudé » du début à la fin.
Vous qui aimez l’excès, le « théâtre plus grand que la vie », la tragédie et le Vaudeville sont-ils pour vous les styles les plus appropriés à l’expression de vos désirs en matière de costume ?
Bien sûr, tout ce qui est extrême. Je n’en ai pratiquement jamais fait, mais cela pourrait aussi s’appliquer au cirque ou au music-hall.

Lorsque vous créez un costume, vous posez-vous la question de la faute de goût ? Que pensez-vous du bon et du mauvais goût, et vous arrive-t-il de vous autocensurer ?
Non, je suis ce que cherche le metteur en scène. Je ne prétends pas avoir bon goût. Il y a une « classe », un chic inné qui ne s’atteint pas comme cela, mais il n’y a pas de bon ou mauvais goût en matière de spectacle. Chacun son goût, bon ou mauvais compris. Il y a aussi des styles qui sont au-delà, comme celui de la famille royale d’Angleterre, etc. Mais je ne me suis jamais autocensuré, d’autant plus que depuis mes 15 ans j’ai gardé comme « motto », comme l’une de mes devises, la phrase de Cocteau : « Ce que le public te reproche, cultive-le, c’est toi. »
Lorsque vous étiez dans la mode, cherchiez-vous à être à la mode ?
Il y a une autre phrase terrible en la matière : « Aussitôt que vous êtes à la mode, vous êtes démodé. » J’ai donc tâché de ne jamais m’inscrire dans le courant de quelque mode que ce soit en m’efforçant de toujours me demander quelle était ma plus intime conviction, le tréfonds de mon envie, la quintessence de mon inspiration me donnant ainsi le plus de chances possibles de n’être que moi-même, de proposer un style personnel mais aussi « partageable », « communicatif ». La haute couture est une forme de théâtre grâce aux clientes de cette époque qui avaient l’étoffe, l’envergure d’héroïnes de tragédie, de roman, mais jusqu’à un certain point, quand il ne s’agissait pas de vrais personnages de presque fiction comme la princesse Thurn und Taxis. Autre devise, de Jean-Jacques Picart : « La mode, c’est comme les bananes, trop tôt, vertes, c’est mauvais, après, trop tard, blettes, c’est mauvais aussi. »
A lire aussi : À la mode de chez qui?
Avez-vous eu des muses ? Avez-vous habillé des chanteuses, des actrices ou des mannequins qui vous ont directement inspiré ?
Pas vraiment. Il y avait un idéal en tête, « plus grand que nature » aussi, extrême, sur laquelle j’ai toujours projeté mes inspirations : Françoise, ma femme, bien sûr. Elle suivait l’élaboration des collections pour me donner l’œil, l’approche, l’attitude de la femme ou de la fille que je ne suis pas même si nous pouvons tous clamer « Madame Bovary, c’est moi », comme Flaubert. Ma féminité évidente ne s’est jamais exprimée par le vêtement. On connaît aussi l’image de Marie Seznec qui a été mon mannequin chez Patou et chez Lacroix avant de diriger les salons. Les personnalités comme la sienne ou celle d’Anh Duong, chez Patou aussi, ou, chez Lacroix, plus tard, Suzanne Von Aichinger donnaient un certain ton, une attitude, un esprit, une sophistication bien à elles, à la fois ancrés dans la grande tradition du « chic » extrême, « glam », « queer », « camp », comme on disait à l’époque, et la modernité totale de leur quotidien « arty », cosmopolite, nocturne, quand la nuit parisienne existait encore entre marginalité et mondanité.
Quelle est pour vous la définition de l’artiste ?
J’ai toujours été d’accord avec celle de Victor Hugo : « messager entre les hommes et les dieux ».
En êtes-vous un ?
Absolument pas, la mode et le design sont des « arts appliqués », mais je ne saurais même pas revendiquer le statut d’artisan. Designer est un mot pratique. Scénographe ou costumier décorateur me vont aussi. Pas artiste en tous les cas.
LA QUESTION D’ARIELLE DOMBASLE
« Artiste, designer de génie, poète, coloriste… quel a été à vos yeux votre geste de mode le plus radical ? »
Chère Arielle, affectueusement merci. Peut-être ma première collection du troisième millénaire faisant table rase de toutes mes caricatures méditerranéennes et historiques par des formes graphiques, géométriques, des aplats de couleurs primaires, des matières indéfinissables. Mais au fond, l’image que je garde comme un porte-bonheur, un emblème, pour ne pas dire une icône personnelle, c’est la mariée rouge et or masquée de la collection Haute Couture automne/hiver 2002 dont la jupe – j’avais épuisé les budgets de la collection – était la cape de paseo brodée que m’avait offerte un ami torero.